Entreprendre pour transformer l’Afrique – Entretien avec Zakaria Fahim
Dans cette interview accordée à Atlas Original, Zakaria Fahim revient sur les idées clés de son ouvrage HUB Africa ou l’amour d’entreprendre et partage sa vision de l’entrepreneuriat africain comme levier de transformation économique et sociale.
ENTREPRENEURIATNEWS
Rédaction Atlas Original
12/23/20257 min read
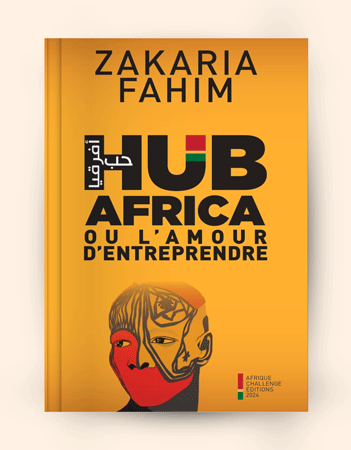
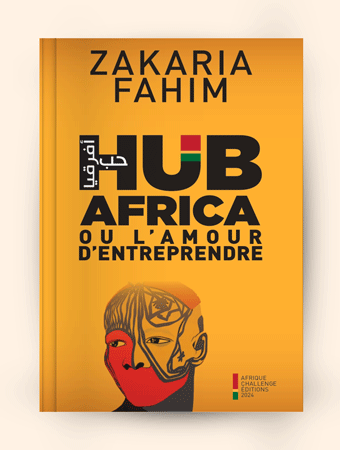


Zakaria Fahim :
Managing Partner BDO Président Hub Africa
Sami, c’est moi… mais c’est surtout nous, tout en faisant un clin d’œil au second prénom de mon fils. J’ai choisi de raconter mon engagement entrepreneurial à travers lui parce que je voulais sortir du discours « expert » et redonner la parole à celui qui doute, qui trébuche, qui recommence. Sami est ce jeune Africain qui a grandi entre deux mondes – le quartier populaire et la mondialisation numérique – et qui se demande : « Est-ce que l’entrepreneuriat peut vraiment changer ma vie, et celle des autres ? »
En passant par la fiction, je peux dire des choses plus directes sur mes propres hésitations, mes colères, mes renoncements et mes combats, sans tomber dans l’autobiographie héroïque. La mise en récit permet aussi de montrer que derrière Hub Africa, les baromètres, les tribunes, il y a d’abord un humain qui a peur de rater… et qui avance quand même. C’est ce décalage-là qui éclaire différemment mon parcours.
Pourquoi avoir choisi de raconter votre engagement entrepreneurial à travers le personnage de Sami ? En quoi cette mise en récit éclaire-t-elle différemment votre parcours ?
Au départ, Hub Africa, je l’ai pensé comme un « tiers de confiance » entre des PME africaines souvent isolées et des financiers trop loin du terrain. Très concrètement : une plateforme où l’on se rencontre, où l’on pitche, où l’on se forme, où l’on accède à des réseaux qui, jusque-là, étaient réservés à quelques-uns.
En douze ans, Hub Africa est devenu beaucoup plus qu’un salon ou un événement : c’est un écosystème. Nous accompagnons des entrepreneurs sur la durée, nous travaillons avec la diaspora, nous portons des plaidoyers comme le Small Business Act for Africa pour donner un vrai pouvoir économique aux TPE-PME, et nous connectons désormais des investisseurs et des entrepreneurs sur plusieurs continents.
L’ambition n’a pas changé : libérer le potentiel des entrepreneurs africains. Mais les outils se sont sophistiqués : bootcamps, pitch roadshows, programmes de diplomatie économique, applications de mise en relation… Hub Africa agit désormais à la fois comme accélérateur, influenceur de politiques publiques et communauté d’entraide structurée.
Quel rôle avez-vous attribué à Hub Africa au moment de sa création, et comment cette plateforme a-t-elle évolué pour accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs africains ?


Si je devais résumer le livre en un seul message, ce serait :
« L’Afrique n’a pas besoin de sauveurs, elle a besoin d’entrepreneurs engagés, structurés et solidaires. »
Tout le reste découle de ça :
l’exigence de professionnaliser nos PME (une PME n’est pas une grande entreprise en miniature, elle a son propre ADN),
la nécessité de créer des écosystèmes plutôt que des héros isolés,
l’urgence d’articuler rêve africain et discipline d’exécution,
et l’idée que l’engagement n’a de sens que s’il crée de la valeur et de l’emploi, pas seulement des discours.
Si vous deviez résumer l’essence du livre en un message central, quel serait-il ?


Nous n’avons pas, au Maroc, un compteur officiel qui dirait : « X emplois sont menacés par an à cause des transmissions ratées ». Ce que nous avons, ce sont des ordres de grandeur extrêmement préoccupants.
On sait que la très grande majorité des entreprises marocaines sont familiales, et que, partout dans le monde, les entreprises familiales représentent une part massive du PIB et de l’emploi. Nos travaux avec le Baromètre de la transmission des entreprises familiales montrent que seule une minorité d’entre elles passe le cap de la troisième génération, alors même qu’elles portent une part essentielle de la valeur créée.
Concrètement, cela veut dire que derrière chaque dossier de transmission mal préparé, ce ne sont pas seulement un patron et ses héritiers qui sont en risque, ce sont des équipes, des territoires, des savoir-faire locaux. On parle de centaines de milliers d’emplois potentiels sur la décennie à venir. Le message du livre est clair : une entreprise qui ne se transmet pas détruit de la richesse et des emplois, alors que bien transmise, elle peut devenir un levier de montée en gamme pour tout le pays.
Dispose-t-on aujourd’hui d’une évaluation du nombre d’emplois potentiellement menacés par les difficultés de transmission des entreprises familiales au Maroc ?
Pendant la COVID, j’ai plaidé pour une relocalisation intelligente et des circuits courts, non pas par nostalgie protectionniste mais par réalisme stratégique : un pays et un continent qui ne maîtrisent pas leurs chaînes de valeur sont vulnérables.
Aujourd’hui, sur le terrain, je vois trois signaux :
Des filières qui se structurent : agroalimentaire, pharmaceutique, textile technique… Des PME africaines reprennent des morceaux de chaîne de valeur, souvent en s’adossant à de grands groupes.
Une demande citoyenne plus consciente : les consommateurs urbains sont plus sensibles à l’origine des produits, à l’impact social, à l’empreinte carbone. C’est encore minoritaire, mais c’est une tendance lourde.
Des politiques publiques qui commencent à suivre, avec des stratégies d’industrialisation, des incitations à l’achat local, et des réflexions sur un Small Business Act adapté à nos réalités.
Sommes-nous allés assez loin ? Non. Mais la bascule mentale est faite : on ne parle plus de relocalisation comme d’un slogan, mais comme d’un chantier d’investissement, d’innovation et de compétences.
Durant la période COVID, vous plaidiez pour une re-localisation et des circuits courts. Où en est cette dynamique aujourd’hui, et quels signaux observez-vous sur le terrain ?
Un monde BANI (BANI = B – Brittle (Fragile) - A – Anxious (Anxieux) - N – Nonlinear (Non linéaire) - I – Incomprehensible (Incompréhensible)) – n’est pas un monde contre l’entrepreneur africain ; c’est un monde qui punit l’improvisation et récompense ceux qui apprennent plus vite que les autres.
Pour s’y adapter, je vois quatre exigences :
L’humilité stratégique : accepter que le plan à cinq ans soit un scénario, pas une certitude, et apprendre à réviser vite.
La culture de la donnée : ne plus piloter « au feeling » mais par les chiffres, les indicateurs, les signaux faibles.
L’écosystème comme assurance-vie : dans un monde non linéaire, personne ne réussit seul.
La souveraineté numérique : protéger ses données, maîtriser ses outils et comprendre la cybersécurité.
Le livre essaie de montrer que ce monde BANI n’est pas une malédiction, mais une invitation à changer de logiciel entrepreneurial.
Dans votre ouvrage, vous qualifiez notre monde de « monde BANI ». Comment les entrepreneurs africains peuvent-ils s’adapter à une telle réalité ?


Oui, c’est plus vrai que jamais. L’histoire ne bouge jamais à la majorité qualifiée ; elle bouge quand une minorité engagée accepte de prendre des risques, de sortir du rang et de payer le prix de ses convictions.
La différence aujourd’hui, c’est que cette minorité peut être distribuée et que l’engagement doit être structuré. Dire que la minorité engagée change le monde, ce n’est pas un slogan romantique, c’est une responsabilité.
Affirmer que « la minorité engagée change le monde » reste-t-il vrai aujourd’hui ?
Je veux que le lecteur ressorte du livre avec une conviction simple : l’Afrique n’est pas un continent en retard, c’est un continent en avance sur certains futurs, et qui doit enfin raconter sa propre trajectoire.
Mon amour pour l’Afrique n’est pas naïf. Il est exigeant : aimer ce continent, c’est se battre pour qu’il soit digne de ses enfants.
Votre livre est aussi une déclaration d’amour à l’Afrique. Quelle vision du continent souhaitez-vous transmettre au lecteur ?


Heureusement, oui. J’ai croisé des dirigeants de PME familiales, des jeunes incubateurs, des responsables publics, des acteurs académiques et des réseaux de la diaspora qui tirent tous dans le même sens.
Le livre montre que la transformation de l’Afrique ne sera pas l’œuvre d’un seul homme, mais d’une constellation d’acteurs engagés.
Avez-vous rencontré, au fil de votre parcours, d’autres acteurs qui portent la même ambition de transformation pour l’Afrique ?
Le « club des cinq » symbolise une évidence : on ne se construit jamais seul. Ils ont tous suivi des chemins différents, mais ce lien est pour moi un rappel permanent de mes origines, de ma responsabilité et du sens du partage.
Ce fil d’amitié, c’est ma boussole. Quand je parle d’inclusion, de PME familières, de Small Business Act, de Hub Africa, je pense à eux, à nos discussions d’ados, à ces quartiers où le talent est là mais les passerelles manquent. Le livre raconte cela : le destin d’un entrepreneur africain n’a de sens que s’il reste relié à son « club des cinq ».
Dans le livre, vous évoquez Moha, Fayrouz, Hassan et Khalid, vos compagnons d’enfance. Que sont-ils devenus et que représente pour vous ce lien d’amitié ?


